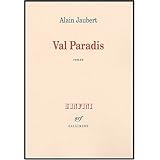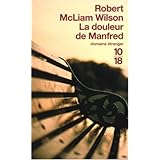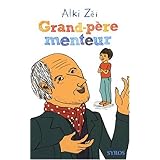tu rassembles lentement
des fragments de lenteur
(Stéphane Despaties, Ce qu’il reste de nous)
Une journée de mer déjà.
C’est long de conjuguer ainsi le temps sur cette île d‘oubli qu‘est un navire. Le jour hier était jaune, étonnamment lumineux (et je m’attendais à toute autre chose sur la Manche, les clichés de grisaille ont la vie dure !). Le ciel en quelque sorte a fait escale lui aussi et soulevé les nuages, comme si ça venait des lointains, et pas une seconde je ne me suis ennuyé, un peu gêné en fin d’après-midi par le tangage et sans doute, l’estomac vide ; je me suis alors étendu en attendant le repas du soir.
La vie à bord est lente, impalpable, presque nonchalante. Un bateau, ça bouge sans cesse pourtant, mais le temps y est immuable, avec seulement le soleil qui poursuit sa course dans le ciel et qui définit le passage des heures. Et puis la nuit, avec mes réveils à quatre heures du matin, cette fois-ci parce que soudain il y avait un fort roulis, et la sensation de rouler d’un côté à l’autre du lit m’a fait comprendre la raison des bords élevés qui empêchent de tomber quand la mer est plus forte. Pourtant, je me suis bien rendormi jusqu’à sept heures.
Maintenant, le cargo est à l’arrêt à Montoir, où doivent embarquer d’autres conteneurs et deux autres passagers, ainsi que le nouveau commandant.
Déjà deux nuits. C’est lors de la première que soudain, j’ai senti que le bateau était parti, ce que j’ai vérifié en soulevant le rideau de mon sabord (car on m’avait enjoint de le tirer pour éviter que les lumières des cabines ne gênent la visibilité des navigants). J’ai fait des rêves étincelants et vérifié le mot d’Henry Bauchau : "L’esprit rejoint la nuit sa demeure première." La deuxième nuit (c‘est-à-dire celle qui vient de se passer), je me suis couché très tôt, de peur d’être incommodé par les roulements des vagues, nous venions de franchir le contournement du Finistère, et le mer était de loin plus forte que la Manche. Mais avant, je suis allé admirer la lune qui coiffait l’échancrure des nuages (je n’ai pas réussi à en tirer une photo). Et dès neuf heures et demi, après avoir lu deux chapitres supplémentaires de La Chartreuse de Parme (que je laisserai à la bibliothèque du bord, pour rehausser un peu son niveau) et frémi des malheurs de la Sanseverina et du bonheur de Fabrice enfermé dans la prison de la Tour Farnèse, et qui pourtant n’a jamais été aussi heureux de sa vie, car il y découvre enfin l’amour, lui qui croyait avoir le cœur sec, j’ai pu "rêver de cet instant / qui fait que l’on glisse / au bout de notre passé" (Stéphane Despaties, Ce qu’il reste de nous).
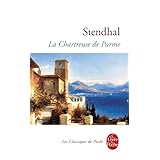
Oui, car il y avait quarante-neuf ans que je n’avais pas lu ce livre, qui m’avait enthousiasmé, comme le film avec Gérard Philipe et Maria Casarès vu à la même époque. C’est le roman de la "chasse au bonheur", et tous les personnages (Fabrice Del Dongo, La Sanseverina, le comte Mosca, Clélia Conti), chacun à leur manière, recherchent, éprouvent l’amour, s’en réjouissent ou en souffrent, et parfois inconsciemment. Livre parfait pour un voyage où "Du fond d’un trou de mémoire / Je regarde passer le ciel" (Serge Wellens, Il m’arrive d’oublier que je perds la mémoire).
Maintenant que je suis de nouveau à quai, sans les soubresauts de la mer ni les vibrations des machineries du navire (heureusement que j’ai mes bouchons auriculaires pour dormir !), une première page s’est achevée. Celle où, dans une relative solitude, j’ai pu comme Michel Baglin, "Trouver passage / jusqu’à soi." Le steward me dit que certains passagers sont intarissables. On verra, et le navire est assez vaste pour échapper aux vains bavardages, avec ses nombreux niveaux, ses coursives (nom des couloirs) labyrinthiques où je me suis déjà perdu, ses ponts, et, de toute façon, la cabine où "Ma tête à moi / les vents y passent "(Emile Verhaeren, Les campagnes hallucinées).
A table, on voit passer au fond des verres le roulis, à moins que ce ne soit le tangage. Pour ne plus être incommodé, je ne boirai plus de vin, c’est peut-être ce qui m’a un peu troublé l’estomac hier après-midi. Mais le ciel est si bleu : que peut-il m’arriver ? « J’ai l’imagination ; toi, tu as la réalité », écrivait Dostoievski dans Humiliés et offensés). Il se trouve qu’ici j’ai les deux, une imagination décuplée par l’absence de tout, le continent dans le dos, mais la réalité de la nuit comme une voûte, et du jour rayonnant devant un soleil vide, nouveau Christophe Colomb en recherche… De quoi ? Du frisson natal ? De découdre l’éternité… Hum, n’exagérons rien, dévider avec humour le peu de temps qu’il me reste à vivre, c‘est déjà pas si mal… Car, comme le rappelle Stendhal (Vie de Henry Brulard) "J’étais à la montée de la vie, et avec quelle imagination de feu ne me figurais-je pas les plaisirs à venir? … Je suis à la descente."
La descente sera-t-elle belle ? À moi de la sculpter ! J’essaie d’en prendre le chemin…