Il m‘a paru que nous étions seules au monde. Nous l‘étions bel et bien, elle arrivée de ses cinquante ans de solitude, et moi de mes dix-huit ans d‘orphelinat à domicile.
(Anne-Marie Garat, Les mal famées)
André Gide notait dans son Journal, le 8 août 1905 : "quelques plongeons dans la solitude me sont aussi indispensables, chaque jour, que le sommeil des nuits. Je m'y défripe". On sent quand même là le littérateur, même si je peux prendre en compte l'idée de se défriper. Moi qui ne me contente plus maintenant de quelques plongeons, mais d'un grand bain dans lequel je patauge...
Je côtoie depuis deux ans divers types de solitude : la mienne d'abord, qui ne ressemble guère à celle que j'appréciais tant quand j'eus quitté la maison et le lycée et ai eu – enfin – une chambre à moi (petit salut à Virginia Woolf ici), et où je pouvais m'écrier, comme le héros de Sandor Márai, dans L'étrangère : "« Enfin seul », pensa-t-il. Une impression de sécurité qu'il n'avait encore jamais éprouvée succéda à son étonnement devant la solitude". Une solitude de jeune homme, si différente de ma solitude d'enfant plongé dans une famille nombreuse, car, comme l'ont indiqué bien des commentateurs, on peut se sentir absolument, incongrument seul dans un groupe, fût-il aimant. Comme le personnage de Mathieu Galey, dans une nouvelle incluse dans son recueil Les vitamines du vinaigre, dont il est dit "de plus, il était encore un peu jeune, bien qu'il fût d'une précocité certaine, pour savoir qu'il était seul, et l'on ne souffre pas d'être seul tant qu'on ignore que d'autres le sont moins que soi". Hé oui, tant qu'on ignore... Je ne suis pas sûr que je l'ignorais, et mes problèmes d'estomac, qui ont commencé vers neuf-dix ans, ne sont pas tout à fait tombés du ciel. C'est toujours dur de se sentir différent. J'étais un peu comme le héros d' Alain Claude Sulzer, Un garçon parfait : "il ressentait à peine sa solitude, il avait toujours été seul".
Mais enfin, maintenant, c'est la solitude de la retraite, de l'âge, du veuvage. Et ça n'a plus rien à voir. À vingt-cinq ans, on peut être seul, on peut en souffrir, mais il y a de l'espoir, on sait qu'on a de l'avenir. À soixante-cinq ans, si je ne quitte pas l'appartement, si je ne vais pas vers les autres, je découvre avec effarement "la sensation étrange de ne jamais entendre le son de ma propre voix" qu'a relevée Charles Dickens dans David Copperfield. Aussi, si on me reproche quelque peu mon nomadisme effréné, il faut le comprendre : quoi qu'on dise, l'homme n'est pas fait pour vivre dans l'isolement, surtout après avoir connu des années de vie communautaire en famille et en couple. Sans doute il y a une solitude du bonheur ; j'ai lu chez Mathieu Galey : "Le bonheur conduit à la solitude ; il vous porte à de telles hauteurs – certains parlent de septième ciel ! - qu'il vous éloigne pour un temps du monde et de la raison communs".
Peut-être me sentais-je dès l'enfance un peu différent des autres, un peu artiste à ma façon – j'ai commencé à écrire des poèmes vers mes douze ans, et je n'ai jamais vraiment cessé d'en écrire. Chacun sait que le "créateur n'a pas d'intimes, c'est par essence un être isolé, un être dont on ne peut être proche", comme le rappelle Gilles Sebhan, dans Domodossola : le suicide de Jean Genet. Et qui peut-être même a besoin, plus que d'autres, de la solitude. Mais enfin, la création se nourrit aussi, et sans doute surtout, de la rencontre des autres, et dans le cas de la poésie et de l'écriture, du langage. On a pourtant remarqué que "le langage bien sûr fonde le grand bavardage entre nous, c'est son indéniable utilité, un son tissé entre des corps, un certain élan jeté vers nous, une marche qui est notre pain quotidien, mais pourtant nous restons d'un côté et de l'autre de sa sorte particulière de clôture, chacun seul dans le parc de son propre lexique" (Stéphane Bouquet, Un peuple).
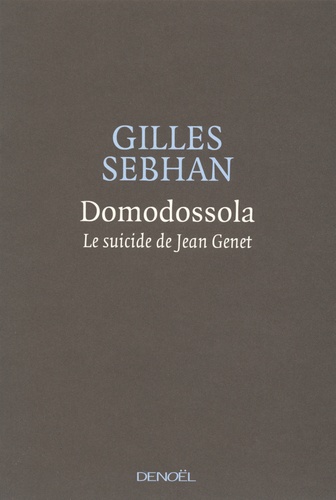
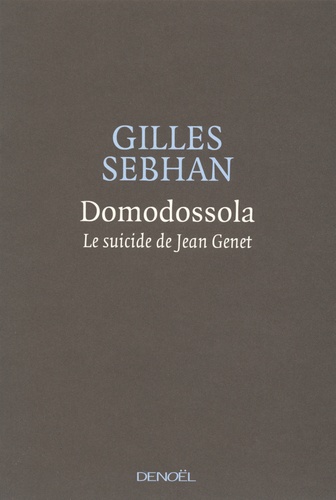
Dans ce même livre, l'auteur nous dit aussi que le poésie se nourrit de la "promenade : toujours solitaire. On y marche à la rencontre de soi, ou de la pensée, de la nature, parfois de Dieu, des dieux, parfois de leur absence, du deuil d'eux, de la continuité sans borne du silence […] On s'extrait des autres hommes pour vivre l'expérience d'une rencontre, d'une contemplation, d'une extase, d'une perte qui est absolument singulière, et d'une certaine façon, qualifie le poète, le désigne comme homme d'exception. On se métamorphose presque en une chose de la nature : le nuage par exemple, la feuille chassée par le vent, l'oiseau, le haricot qui pousse – quelque chose qui porte et devient le mouvement pur, le souffle de l'esprit, l'errance vers sans doute un ancien savoir".
Sans doute n'ai-je pas à me plaindre ; le poète néerlandais Menno Wigman, que j'ai rencontré cet été a écrit dans un de ses poèmes : "Qu'est-ce que je savais des trappes de la nuit, / lorsqu'on se retrouve sans argent ou amis ? " Car, au contraire de bien des personnes que je rencontre ou même que je fréquente, je ne suis pas sans argent ni amis. Et même quand mes ami(e)s me semblent lointains ou indifférents, je ne suis pas loin de penser comme Hervé Guibert dans son Journal : "Je peux me dire que T. m'est l'être « le plus cher au monde » : il n'est pas là, et pourtant je continue à vivre, son absence n'est pas insupportable, il pourrait ne pas exister, je serais toujours vivant". D'une certaine façon, c'est bien aussi ce qui m'arrive avec l'absence de Claire, je suis toujours vivant. Je réalise alors comme l'a rapporté Colette que "l'isolement, oui. Je m'en effrayai, comme d'un remède qui peut tuer. Et puis je découvris que... je ne faisais que continuer à vivre seule" (La vagabonde).
J'ai la chance d'aimer lire, d'aimer la littérature, et je dirais même toutes sortes de littératures ; je peux proclamer comme Mathieu Lindon : "Pour mon bonheur et mon malheur, j'adore lire, la solitude m'est une amie qui me délivre de la peine d'en chercher d'autres" (Ce qu'aimer veut dire). Et, comme on le voit, de noter pendant que je lis, et de truffer mes propres textes de ce que je découvre chez les autres. Car j'aime écrire aussi, ce qui est pour moi une nécessité de ma vie intérieure : "Il est vrai aussi qu‘une aventure intérieure authentique ne peut se vivre que dans la retraite, la solitude", a noté Charles Juliet, dans Cézanne un grand vivant.
J'ai la chance aussi d'aimer aussi des activités solitaires, comme le vélo (qui peut toutefois se pratiquer à deux, voire en groupe) ou la course à pied. Je peux faire miennes les réflexions de Haruki Murakami, dans son bel Autoportrait de l’auteur en coureur de fond : "C‘est pourquoi je dois sans cesse maintenir mon corps en mouvement et quelquefois le pousser jusqu‘à ses limites, afin de guérir la solitude que je ressens au fond de moi, ou au moins de la relativiser. […] Je suis le genre d’homme qui aime faire les choses – quoi que ce soit – tout seul. Et pour être encore plus direct, je dirai que je suis le genre d’homme qui ne trouve pas pénible d’être seul". En tout cas, je les faisais miennes, ces réflexions, quand j'avais la trentaine et courais des marathons, et en particulier, j'aime ce mot de relativiser. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai davantage de mal à relativiser. Quand je rentre chez moi, après une visite, une sortie, un petit ou grand voyage, je suis comme le héros de Robert McLiam Wilson, La douleur de Manfred : "Mais il appréhendait la solitude de son appartement – inutile de presser le pas pour retrouver ce lieu désert. Il n‘y avait personne pour remplir les endroits vides de son logement". Ou au retour de « vacances » (drôle de mot pour moi, elles sont devenues perpétuelles), je suis comme les héroïnes d' Alain Claude Sulzer : "car ce qui succédait à ces vacances était bien pire que la solitude. Car là où elles retournaient, personne ne les attendait..."
Bien sûr, on peut aussi être seul à deux, voire à plusieurs, et je ne l'ignore pas plus qu'Alejandra Pizarnik, qui notait dans son journal le 15 octobre 1962 : "Béquilles que t'offre l'amour, qui te permet de te redresser, te fait marcher – quoique péniblement – pour ne pas basculer dans la folie ou le suicide. Plus encore, il te donne la matière du chant, la matière des pleurs. En somme, il te donne l'illusion de faire partie du monde, toi qui es exclue depuis que tu te connais". Oserais-je dire que je n'ai plus réellement de béquilles (l'amour de mes enfants, de quelques membres de ma famille, de quelques ami(e)s ?), que je n'ai plus d'illusions non plus ? C'est peut-être le commencement de la sagesse ?
Pour échapper au carcan de la solitude, je me remplis d'obligations : visites à l'un, à l'autre, sorties associatives, accueil chez moi d'étrangers, nombreux déplacements, vacances et voyages surprenants (je suis de plus en plus tenté par le tour du monde en cargo), mais je tombe alors dans "ce semblant d'abondance qu'un agenda rempli donne à une vie" (Christiane Veschambre, Les mots pauvres), et qui n'a jamais empêché personne de se sentir souvent comme Imre Kertesz, "totalement étranger dans mon pays, étranger parmi les hommes, étranger au monde" (Journal de galère). Mais l'oisiveté n'est pas mon fort. J'ai beau lire Montaigne, ça m'aide, bien sûr, mais ce n'est pas d'un grand secours, lui qui a pourtant écrit : "Nous avons une âme capable de se replier sur elle-même ; elle peut se tenir compagnie, elle a de quoi attaquer et de quoi se défendre, de quoi recevoir et de quoi donner. Ne craignons donc pas, dans cette solitude, de croupir dans une oisiveté ennuyeuse" (Les Essais, I, 38.16). Et il y a les jours vides. "Je hais les dimanches", chantait Juliette Gréco. Et Rosa Luxemburg renchérissait, dans une lettre adressée de sa prison à son amie Sonia Liebknecht, le 18 février 1917 : "N'oublions pas que pour moi, c'est tous les jours dimanche. C’est aujourd’hui dimanche, encore dimanche, le jour le plus mortel pour les prisonniers et les solitaires". Que dire des dimanches quotidiens, sept jours sur sept, des retraités ?
Il est vrai que d'un jour à l'autre, la solitude n'a pas la même tonalité, comme l'avait remarqué Colette : "il y a des jours où la solitude, pour un être de mon âge, est un vin grisant qui vous saoule de liberté, et d‘autres jours où c‘est un tonique amer, et d‘autres jours où c‘est un poison qui vous jette la tête aux murs". Entre les jours où on apprécie (« Enfin seul ! ») et ceux où on se dit, comme Alejandra Pizarnik : "Même si on n'est pas amoureux, parfois, au beau milieu de la solitude, ou d'un abandon lugubre, surgissent des désirs que les autres ont aussi : une main sur l'épaule, des paroles affectueuses...Tu ne fais de mal à personne avec ces désirs. En fait, ils ne demandent aucun réel effort à la personne qui pourrait (et devrait) les exaucer". Eh bien, il faut croire que ça demande un sacré effort, car ces désirs sont rarement réalisés, et parfois, j'ai envie de crier comme le Goetz de Jean-Paul Sartre, dans Le diable et le bon Dieu : "Dieu, c’est la solitude des hommes". Et qui va briser les barreaux dont parle Eddy Harris dans Harlem : "C'est l'isolement qui crée la prison, bien sûr, et comme pour n'importe quelle prison, il y a réclusion de part et d'autre des barreaux" ? Cet isolement qui me paraît quand même propre au monde moderne avec ses murs, ses portes blindées (ma résidence est un véritable bunker), ce qui est déjà beaucoup, mais aussi ses âmes renfrognées et ses cœurs fermés, ce qui est plus grave ; Allan Bloom, le philosophe américain de L’amour et l’amitié, l'avait bien relevé : "L’isolement, le sentiment de ne pouvoir établir un contact en profondeur avec d’autres êtres humains, telle est, semble-t-il, la maladie de notre temps".
Et puis, il y a quand même la mort à laquelle je pense maintenant très souvent, moi qui comme Brassens, commence à être "cerné de près par les enterrements". Même entouré, on meurt seul : "En tant que mort j'en serais un parmi bien d'autres ; en tant que je meurs je suis seul" (Fritz Zorn, Mars). Et voilà, la boucle est bouclée, on tombe dans l'isolement absolu. L'affrontement avec le néant, ou avec Dieu. Mais est-il nécessaire que le néant commence avant, qu'on en connaisse un avant-goût à un âge avancé sans doute, mais pas si élevé que ça ? Comment se fait-il que les liens inter-générationnels soient si distendus, au point qu'on cache nos vieux dans des mouroirs qui n'osent pas dire leur nom ? Qu'on laisse des gens dans la rue, dans le froid (ou la chaleur) et dans une solitude absolue ? C'est immonde...

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire