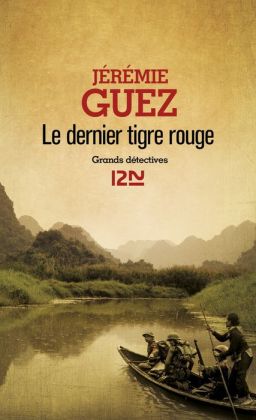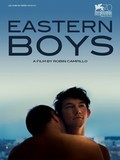Quand
les élèves croient à ce qu'ils font, ils ne s'arrêtent plus. Ils
travaillent. Ne rien faire n'est pas ce qu'ils recherchent. Il faut
du sens à ce qu'on leur demande, c'est tout.
(Jeanne
Benameur, Présent ?,
Denoël, 2006)
Le
monde moderne a si rapidement changé que la rupture entre enfants,
adolescents et le monde enseignant est devenue béante : "Ce
n'est pas un fossé qu'il y a entre ceux qui croient donner et ceux
qui ne peuvent recevoir, c'est une fosse."
L'école de ma jeunesse n'avait pratiquement que peu changé depuis
Jules Ferry. Je me souviens que dans mon école de village, la
plupart des livres de la bibliothèque dataient d'avant la guerre de
14. Ce n'était certes pas un gros encouragement à la lecture, et
cependant, nous étions avides de savoir, et le "professeur
était celui par qui le savoir arrivait. Aujourd'hui, le savoir
arrive, diffracté, par mille canaux. On a l'impression qu'on
pourrait tout faire, de chez soi, avec un écran d'ordinateur, alors
à quoi bon l'humain ?" Comment alors jeunes et enseignants
peuvent-ils s'en sortir ? Eh bien, peut-être en prenant la
réalité à bras le corps, et les jeunes pour ce qu'ils sont, telle
semble être la leçon du superbe roman de Jeanne Benameur, Présent ?
(Denoël, 2006 ; rééd. en poche, Folio Gallimard, 2008, n° 4728).

Nous
sommes dans un collège de banlieue le jour du dernier conseil de
classe, conseil qui sert d’orientation pour une classe de 3e. Là va donc se jouer la décision de l’avenir des élèves de cette
classe : voie de garage ou voie royale ? L'action se
déroule en une seule journée. Nous suivons au fil des heures la
Principale, Marie-Claire Devert, plusieurs enseignants, Paul Aubin,
le professeur d'histoire-géo à l'orée de la retraite, le
professeur de français, Luc Masson, la professeur de SVT, Valérie
Lavalette, la professeur principale, Inès Régnier, le conseiller
d’orientation, Étienne,
quelques
parents, le personnel de service (ATOS) et le «factotum» qui
connaît tous les tours et détours et possède les précieuses clés,
la documentaliste, Laurence Pascalet, et bien sûr quelques élèves,
dont les deux délégués de classe, Aminata, fille d'immigrés et
Laurent, fils d'un boucher lui-même délégué des parents. L'auteur
nous promène en long et large dans le collège, au gré des heures
de cours, des récréations, des pauses en salle de professeurs ou à
la cantine, et enfin pendant le conseil de classe et ses suites.
Chaque personnage est suivi dans ce qu'il a d'humain (ou d'inhumain)
en cette toute fin d'année scolaire.
La
vie est éprouvante ici, car le collège est en zone difficile et les
moyens ne suivent pas : "l'argent
ira là où tout va bien et on laissera crever un peu plus les lieux
difficiles, ceux où on a justement tellement besoin de ce qui est
jugé « annexe ». Mais que veut-on faire de ces enfants ?
On veut les rendre encore un peu plus violents ? Encore un peu
plus largués dans un système qui ne veut rien voir de ses
failles ?",
s'interroge le personnel.
La principale s'en inquiète et fait ce qu'elle peut, elle qui se
pose des questions sur sa propre vie, elle qui a refusé vingt ans
plus tôt une voie peut-être meilleure, en tout cas différente :elle
a "laissé
filer l'homme qu'elle aimait, seul, a refusé de le suivre à l'autre
bout du monde. Il était photographe. Elle avait peur de la vie trop
précaire qu'il lui offrait. Elle n'a jamais cessé de le regretter
mais voilà, elle s'était mise à l'abri. De quoi ? Du désir ?
Est-ce raisonnable de se mettre à l'abri de ce qui fait vivre ?" Au fond, elle s'est fait une raison.
Le
prof de français, lui, n'arrive plus à lire chez lui, submergé par
le flot de copies à corriger. Il reste dans sa classe et se plonge
dans un livre lors des récréations, plutôt que d'aller en salle des profs entendre des jérémiades. Et ce jour-là, après tout
c'est la fin de l'année, il peut bien sortir du programme et montrer
enfin ce qu'il aime, quand les élèves rentrent, surprise. Le prof
reste debout, appuyé sur le bureau, il ne fait pas le sacro-saint
appel, mais il entame, devant les élèves médusés et bientôt captivés, une lecture à
haute voix : il leur lit La métamorphose, de Kafka. Il
sait que lire, "c’est
laisser des images se former à partir des mots choisis par les
auteurs", et que ce qui
manque le plus à ces jeunes, saturés de bruits, d'images imposées
par la pub, internet, la télé, les portables ("La
téléphonie illimitée, l'Internet illimité... on paye des forfaits
et en avant, plus d'espace plus de temps, on peut se croire libre. De
parler et parler encore. Communiquer comme ils disent tous. On est
juste autorisé à bavarder sans fin. Il suffit de payer"),
c'est de former leur propre imagination. Il sait aussi que ces jeunes
n'arrivent plus à communiquer avec leurs parents. Il leur dit que
Kafka n'y arrivait pas non plus, qu'il a écrit pour lui-même une Lettre
au père, que l'écriture, ça sert aussi à ça. Et justement,
ça déclenche chez quelques élèves le désir d'aller chercher au
CDI le livre.
Or,
dès la fin du cours, D., l'élève le plus difficile, toujours prêt
à en découdre pour un mot ou un regard, déboule au CDI. La
documentaliste, qui croit à ce qu'elle fait, ne cesse de penser que
ces jeunes ne sont pas mauvais : "ce n'est pas de
haine qu'il s'agit. La haine anime une intention. Elle s'adresse à
l'autre. Ici c'est la rage qui est à l’œuvre. La rage dit quelque
chose en soi qui ne trouve pas d'issue."
Justement, elle s'apprêtait à commencer un atelier d'écriture, avec des élèves de
toutes classes volontaires. Elle réussit à convaincre le jeune D.
d'y participer. Ici, pas de notes, lui dit-elle, on écrit ce que
l'on veut, on n'est pas obligé de le montrer aux autres, et si on bute sur
l'orthographe, il y a tous les dictionnaires qu'il faut. Découverte
pour D., venu chercher la fameuse Lettre
au père.
Lui, le bagarreur, accepte le défi du thème proposé (le « labyrinthe »),
il arrive à écrire et il reprend confiance en lui.
Laurence
Pascalet croit à la vertu de l'écriture et de la littérature :
elle a même fait découvrir la lecture à une des dames de service qui vient de temps en temps lire au CDI (impossible chez elle, son mari ne comprendrait pas !). Si Laurence a choisi ce
métier, c'est qu'elle ne veut pas laisser les coups remplacer le
langage : "Ce
que les élèves trouvent ici c'est autant de gagné pour la suite de
leur vie. Ça va bien au-delà des programmes. Quand elle leur lit
les textes des auteurs les plus difficiles, elle sent qu'elle aussi a
gagné."
Elle pense d'ailleurs qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les
bœufs : "Si
on met la maîtrise de la langue comme sentinelle à la porte, on se
trompe. On arrête le processus. Les élèves n'osent plus employer
certains mots par peur de ne pas en connaître l'orthographe. On fait
le travail à l'envers. Ils restent dans le champ de la centaine de
termes connus. Ils n'apprennent rien." Et ils apprendront s'il trouvent du sens.
La
jeune prof de SVT, elle, a raté son année, qui était sa première.
Elle ne supporte plus d’aller au collège : elle a perdu
définitivement confiance en elle, elle n’a aucune autorité sur
les élèves, et s'absente le plus souvent qu'elle peut. Elle ne
comprend pas ces jeunes sans repères et sans désir d'apprendre :
"Son
monde à elle est si loin du leur. Elle n'a pas eu les mêmes repères
qu'eux. Elle a aimé ses profs qui lui faisaient découvrir un monde
auquel, chez elle, elle n'avait pas accès. La connaissance, les
livres, la réflexion".
Sa seule ressource, ce sont les visites de son amoureux, encore à
l'université, malheureusement lointaine, et avec qui elle ne peut
passer qu'un week-end sur deux. Et la mer, la Bretagne et ses ciels,
près de quoi elle a passé sa jeunesse, lui manquent. La banlieue,
le béton l'étouffent.
Le
conseiller d'orientation-psychologue souhaite le mieux pour chacun
des élèves. Par exemple, Madison, cette élève quasiment nulle
dans presque toutes les matières, et qui passe tout son temps, même
pendant les cours, à dessiner, à croquer les professeurs, on doit
pouvoir la sauver, lui permettre un jour d'entrer dans une école
d'art, pour parfaire son talent. Mais voilà, le professeur d'arts
plastiques ne viendra pas au conseil de classe, son avis ne compte
jamais, dit-il. Madison est pourtant l'élève la plus douée qu'il
ait jamais eue. Et le conseiller, comme la documentaliste, pensent
que, comme la littérature, l'art est tellement important dans la vie. Ils se souviennent du
roman de Kazantzaki, Alexis Zorba :
"Il
ne viendrait à l'esprit de personne de se dire qu'on va à l'école
pour apprendre à danser, à chanter, à peindre. Pourtant. Que
fait Zorba quand son enfant meurt ? Que fait-il pour continuer à
vivre ? Il tape son talon sur la terre, il lève les bras au
ciel et il danse. Tout le désespoir du monde entraîne son corps, le
soulève, le fait retomber dans la poussière, et recommencer. Il
danse la mort de son enfant. Sans l'art un être humain peut crever
de douleur. Pourquoi
les matières artistiques alors ne sont-elles pas au cœur de tout
lieu d'enseignement ?"
Enfin, le conseiller d'orientation en a marre d'être considéré
comme un homme à chiffres : "Tout
ce qui se passe ici, c'est complexe, passionnant, parce que c'est de
la vie en transformation, et on voudrait les ratatiner en
statistiques imbéciles ?",
parce que c'est ce que réclamé l'administration.
On est dans l'humain, que diable : "Trop
d'élèves sont dans des situations si intenables qu'ils n'arrivent
plus à rien. Les préoccupations d'une vie de misère, ça occupe
tout. Plus de place dans la tête pour un petit espace vide, celui
qui accueillerait le savoir."
Tous
deux, le conseiller, la documentaliste, rejoints d'ailleurs par
quelques profs, ont une vision ouverte de la vie, et subodorent qu'il
faut la communiquer, cette vision à ces élèves paumés et
indisciplinés : "Ne soyons pas raisonnable. Surtout pas.
Quand il s'agit de choisir pour quoi on va se lever chaque matin, il
ne faut pas être raisonnable, il faut être un vrai rêveur de sa
vie." Laurence en particulier pense aux pouvoirs de la
littérature et du rêve : "Avec
la force des rêves, on va. Et si on n'atteint pas le rêve, cela n'a
pas d'importance parce qu'on a tout de même fait du chemin et en
chemin on rencontre, parfois on se rencontre soi-même, et c'est ça,
œuvrer pour vivre."
Jeanne
Benameur, dont j'avais beaucoup apprécié Les
demeurées
et Les
insurrections singulières,
signe ici un roman magnifique, bouleversant, d'une vérité
tranchante. Elle-même fille d'immigrés, fut professeur de lettres
et sait de quoi elle parle. Le roman est construit en petits tableaux
assez courts qui nous font entrer peu à peu dans la tête de chacun
de ces enseignants, du personnel ATOS (très beau portrait du
« factotum » et de sa femme), de quelques parents (oh,
cette mère d'élève qui regrette presque que son fils soit bon
élève, ce qui va inexorablement l'éloigner d'elle : "elle
aime regarder le monde de cette fenêtre. Elle lève les yeux vers le
ciel et se demande pourquoi son mari ne veut pas que leur enfant ait
la même vie qu'eux. Est-ce que leur vie ne vaut rien ?")
et aussi des élèves.
On
est souvent dans l'empathie, dans l'émotion, dans la sensation, dans
le vécu intérieur, dans le concret. On sent que tout est prêt à
exploser, et effectivement, les chapitres consacrés au conseil de
classe font se nouer les tensions : la prof de SVT démissionne,
les professeurs humanistes, soutenus par la documentaliste et le
conseiller d'orientation, ceux qui n'ont pas encore baissé les bras
et se gardent de porter un jugement définitif, prennent le parti des
élèves difficiles, la rigide professeur principale doit se
soumettre à leur vision plus humaine des choses, et à ne pas
décider abruptement de la vie future de ces jeunes. Les dernières
pages nous montrent pourtant que l'émeute éclate, et que des élèves
du collège y participent. Au fond, la violence trop longtemps cachée qui se manifeste là, est celle de ceux qui ne savent pas
s’exprimer – ou mal, de ceux qui sont mis au rancart, des
naufragés de la vie. Présent ?
est un roman écrit avec l’énergie du désespoir, avec la
générosité aussi de ceux qui n'acceptent pas la fatalité et qui
désirent combattre l’humiliation. C'est très beau.